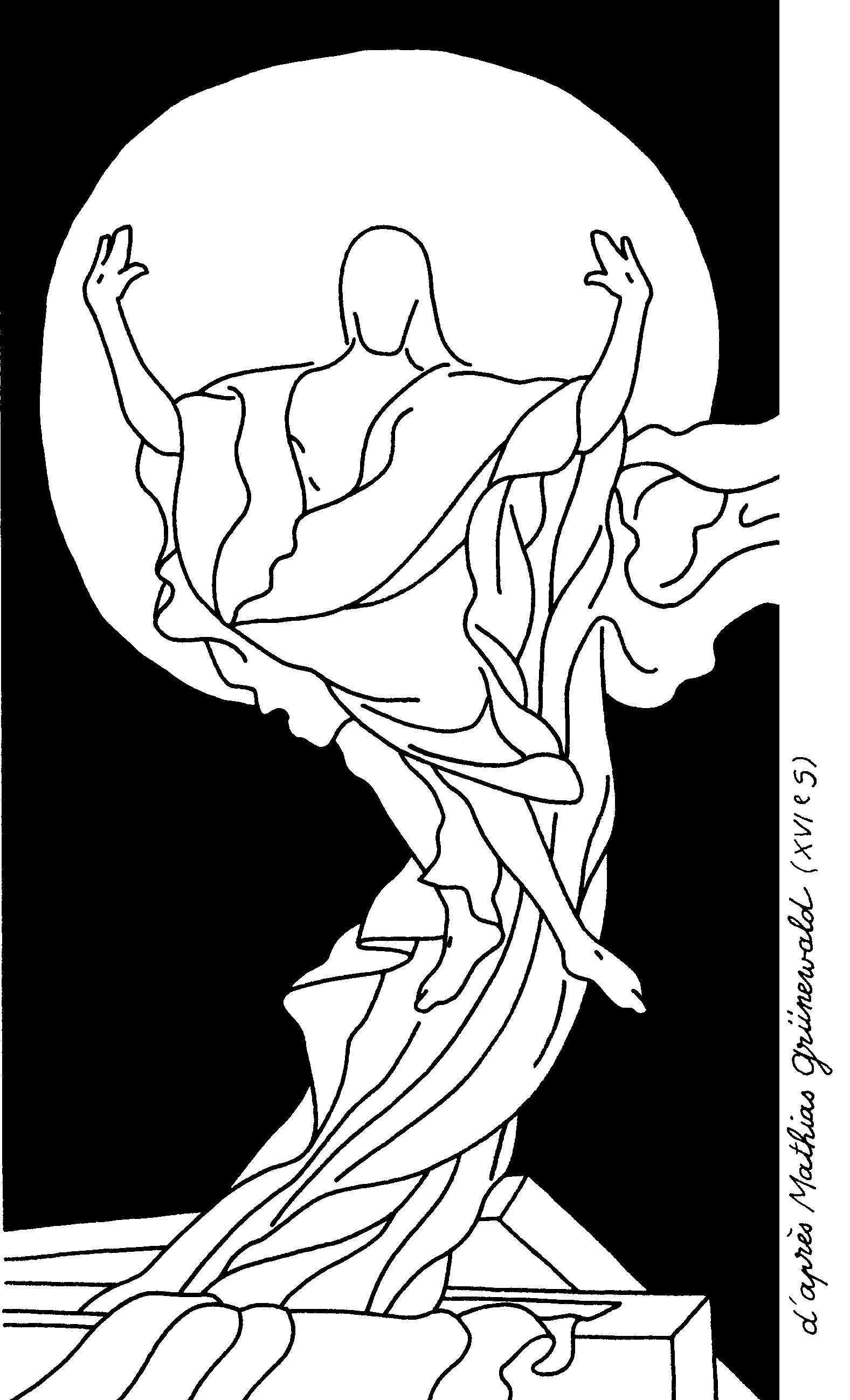
Origines.
Le site des racines de la foi catholique.
-----
Vigile pascale.
|
|
Origines. Le site des racines de la foi catholique. ----- Vigile pascale. |
La veillée pascale est, par essence, une célébration nocturne. Elle peut commencer dès la nuit tombée ; elle doit prendre fin avant le lever du soleil. Le plus grand nombre des communautés de chrétiens lui consacrent la première partie de la nuit mais, en certaines régions coutumières du lever matinal, c'est un office de la fin de la nuit.
Il convient que la veillée rassemble dans une même expression de leur foi tous les fidèles d'un territoire donné, même ceux qui d'ordinaire ont leurs propres assemblées. Il convient aussi qu'elle soit une veillée baptismale. A défaut de baptêmes d'adultes, on aimera à y baptiser des petits enfants.
Structure
L'ouverture de la veillée : le feu nouveau et le cierge pascal.
Le peuple se rassemble hors de l'église autour d'un feu. Après avoir salué l'assemblée, le prêtre lui explique brièvement le sens de la veillée de cette nuit et il bénit le feu. Puis il procède à la préparation du cierge pascal, en le marquant d'une croix et du millésime de l'année au moyen d'un stylet. Il allume ensuite le cierge avec une flamme provenant du feu nouveau, en évoquant "la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire". Le diacre ou, à son défaut, le prêtre prend le cierge et, le tenant élevé face au peuple, chante : "Lumière du Christ". L'assemblée fait alors son entrée dans l'église plongée dans la nuit. Le prêtre d'abord, puis tous les fidèles allument leur propre cierge à la flamme du cierge pascal, tandis que, pour une deuxième, puis une troisième fois, retentit l'acclamation : "Lumière du Christ !" Cette procession évoque le cheminement du peuple hébreu dans le désert à la suite de la colonne de feu, mais plus encore la parole de Jésus : "Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres" (Jn 8, 12).
Lorsque le cierge pascal a été placé sur un chandelier près de l'ambon, où il demeurera durant tout le temps pascal, le diacre chante l'Exsultet, qui est à la fois prière d'offrande du cierge à Dieu et annonce de la Pâque dans une joyeuse action de grâce, où le lyrisme ne le cède qu'à la profondeur.
La liturgie de la Parole.
La liturgie de la parole est particulière : on proclame neuf lectures en y intercalant psaumes et oraisons.
L'une des oraisons de la veillée déclare que "Dieu veut nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament". Pour qu'il en soit ainsi il convient que la liturgie de la Parole soit longue. C'est le moment par excellence où le peuple rassemblé veille et prie en commun dans l'attente de son Seigneur. Si l'on n'est tenu de faire que deux lectures de l'Ancien Testament, dont le récit du passage de la Mer Rouge (lecture 3), seule la lecture intégrale des sept textes proposés, entrecoupés du chant des psaumes ou cantiques bibliques et des prières, constitue à proprement parler une "veillée".
La liturgie baptismale.
La liturgie baptismale comporte, en premier lieu, la bénédiction de l'eau qui sera utilisée pour la célébration des baptêmes durant tout le temps pascal. Elle commence par le chant des litanies, qu'on peut omettre s'il n'y a pas de baptême à la veillée pascale. Puis vient la prière de bénédiction de l'eau. C'est l'antique prière romaine, qui a toutefois été quelque peu aménagée pour souligner davantage les figures baptismales du Nouveau Testament après celles de l'Ancien. Elle évoque ainsi successivement les eaux originelles, le déluge, le passage de la Mer Rouge, puis le baptême de Jésus par Jean, l'eau qui jaillit du côté ouvert de Jésus en croix et la mission donnée à ses Apôtres par le Seigneur ressuscité : "Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit". En invoquant la venue de la puissance du Saint Esprit sur l'eau, le prêtre peur y plonger symboliquement le cierge pascal.
La bénédiction de l'eau achevée, chacun des catéchumènes, adulte puis enfant, est baptisé selon le rite habituel renonciation au démon et profession de foi (par les parents et les parrains et marraines pour les petits enfants), puis immersion totale ou partielle dans l'eau, ou bien triple effusion d'eau sur la tête du baptisé. Vient ensuite pour les petits enfants, qui seront confirmés plus tard, l'onction de saint Chrême. Pour les baptisés adultes on omet cette onction, car ils vont recevoir immédiatement l'onction de la confirmation. C'est enfin la remise du vêtement blanc et du cierge allumé à la flamme pascale.
La confirmation est conférée par l'évêque, s'il est présent, ou par le prêtre qui vient de donner le baptême. On suit le rite habituel.
Après les baptêmes a lieu la rénovation de la profession de foi baptismale par l'assemblée. Mais, s'il n'y a pas eu de baptêmes et si même il n'y a pas de fontaine baptismale dans l'église, le prêtre commence par bénir l'eau pour l'aspersion. C'est une prière nouvelle après avoir rappelé le symbolisme naturel et biblique de l'eau, elle fait mémoire du baptême reçu par chacun des membres de l'assemblée et associe celle-ci à la joie de ceux qui, à travers le monde, reçoivent à cette heure le baptême.
Le dialogue entre le prêtre et les fidèles pour la renonciation au démon et la profession de foi est celui du baptême, conformément à l'Ordo de 1951. Le prêtre parcourt ensuite l'église en aspergeant l'assemblée avec l'eau baptismale ou l'eau nouvellement bénite.
La liturgie eucharistique.
La liturgie eucharistique se déroule comme à l'accoutumée. La préface, en son texte latin, rappelle le rayonnement cosmique du mystère pascal. il est vraiment fête pour le monde, il inaugure les cieux nouveaux et la terre nouvelle : Totus in orbe terrarum mundus exsultat. En communiant pour la première fois au milieu de leurs frères, les nouveaux baptisés adultes achèvent leur initiation chrétienne. Pour que se réalise dans la nuit sainte la plénitude du signe de la participation à la table du Seigneur, il convient hautement que tous communient à la coupe après avoir reçu le pain de la vie.
C'est au chant répété de l'alléluia que le prêtre renvoie le peuple dans la paix et que celui-ci clame sa joyeuse action de grâce.
Historique
Le samedi saint, le Grand Samedi, comme l'appellent les chrétiens d'Orient, honore le repos de Jésus dans le tombeau, mais aussi sa descente aux enfers, sa mystérieuse rencontre avec tous ceux qui attendaient que s'ouvrît la porte du ciel, comme l'enseigne l'apôtre Pierre (1P 3,19-20 ; 4, 6). C'est une journée de recueillement dans la paix et dans l'attente. Aux premiers siècles, la caractéristique essentielle de ce jour était le jeûne absolu, qui constituait la première phase de la célébration pascale. Plus tard, on convoqua les catéchumènes dans la matinée pour la "reddition du symbole" qui leur avait été transmis durant le carême, c'est-à-dire la proclamation publique de leur foi devant l'assemblée des fidèles. Saint Augustin en a laissé une description vivante.
En dehors de l'office quotidien du matin et du soir, l'Église n'a jamais voulu instituer de célébration spécifique pour honorer le séjour du Christ au tombeau. Malheureusement l'anticipation progressive de la veillée pascale devait combler de plus en plus ce vide si éloquent. Lorsqu'à partir du XVI° siècle on célébra la veillée pascale le matin, on entendit les cloches de Pâques carillonner dès la matinée du samedi. Celui-ci perdait dés lors toute sa signification originelle. L'un des bienfaits de la réintégration de la veillée sainte dans la nuit a été de rendre le samedi saint à sa signification première.
Spiritualité
A la charnière du mystère de la passion et de la résurrection.
Point culminant de l'année liturgique, "l'insigne solennité de cette nuit" appartient encore au temps où l'on célèbre la mort du Christ, et "elle appartient déjà au commencement du dimanche, que le Seigneur a consacré par la gloire de sa résurrection". Cette nuit est donc située à la charnière du mystère du salut. De là vient que le dies dominica entre en même temps dans un double calcul. Il est le troisième jour du triduum pascal et le premier jour de la Cinquantaine. Impossible d'ailleurs de le partager entre ces deux appartenances. Dans son unité, il regarde à la fois vers le vendredi saint et le temps de la préparation de la Pâque, et vers la Cinquantaine qui célèbre continûment le triomphe du Ressuscité.
Mystère du Christ sauveur et mystère du chrétien sauvé.
En célébrant la mort et la résurrection du Christ, l'Eglise ne rappelle pas simplement un événement historique passé. Elle célèbre "sacramentellement" le mystère du salut et, en évoquant la mort et la résurrection du Christ, elle en actualise l'efficience mystérieuse. Le mystère de la Pâque est donc à la fois le mystère du Christ, tête, et le mystère de l'Église, corps du Christ. Dans la veillée pascale, le Christ applique plus spécialement à son Église la puissance salvifique de sa mort et de sa résurrection, et le moyen de son intervention est la célébration même que l'Église en fait.
"La mère de toutes les saintes veillées".
Il n'est pas sans importance que l'assemblée des chrétiens célèbre le mystère pascal au cours d'une veillée de prière, à l'écoute de la parole de Dieu et dans la célébration des sacrements. Saint Augustin appelle la veillée pascale "la mère de toutes les saintes veillées". Le Missel de 1970 en résume la signification dans ces termes :
Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est "une veille en l'honneur du Seigneur" (Ex 12, 42). Elle est ordonnée de telle sorte que, selon la recommandation de l'évangile (Lc 12, 35 Sq.), les fidèles, tenant en mains leurs flambeaux allumés, soient semblables à des hommes qui attendent leur maure, afin qu'à son retour il les trouve en train de veiller et les fasse asseoir à sa table.
Souvenir de l'exode du peuple de l'ancienne Alliance, de la mort et de la résurrection du Seigneur, présence du Christ ressuscité à l'assemblée du peuple de la nouvelle Alliance dans les sacrements de l'initiation chrétienne, attente de son retour, dont on crut longtemps qu'il surviendrait précisément dans la nuit de Pâques, tel est le contenu de la veillée sainte. L'Exsultet évoque successivement tous ces aspects :
Voici la fête de la Pâque dans laquelle est mis à mort l'Agneau véritable dont le sang consacre les portes des croyants.
Voici la nuit où tu as tiré d'Egypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur as fait passer la mer Rouge à pied sec.
C'est la nuit où le feu d'une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. C'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui, aujourd'hui et dans tout l'univers, ont mis leur foi dans le Christ : Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints.
Voici la nuit où le Christ brisant les liens de la mort, s'sont relevé, victorieux, des enfers. [...]
Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père saint, en sacrifice du soir la flamme montant de cette colonne de cire que l'Eglise t'offre par nos mains. [...]
O nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu.
Permets que ce cierge pascal, consacré à ton nom, brûle sans déclin dans cette nuit...
Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix.
Commentaire des textes
Le choix des lectures.
Six des sept lectures de l'Ancien Testament ont été choisies parmi les douze lectures antérieures à 1951 ; la septième a remplacé Ezéchiel 37, utilisé à la messe du soir de la Pentecôte, par Ezéchiel 36 interprété par les Pères comme une annonce du baptême. Plusieurs de ces textes sont lus également à pareil jour dans les Églises d'Orient. On se trouve donc en présence d'un fonds catéchétique universel. Le choix n'a pas été fait au hasard. Il s'enracine dans la tradition juive. En effet, selon le Targum palestinien, les Juifs commémoraient durant la nuit de Pâques le souvenir de "Quatre Nuits", celles de la création du monde, du sacrifice d'Abraham, de l'Exode et de la venue du Messie. Or les sept lectures paléotestamentaires de la veillée pascale des chrétiens commencent précisément par les récits de la création, du sacrifice d'Abraham et du passage de la Mer Rouge, suivis d'un texte eschatologique au livre d'Isaïe (Is 54, 5-14). Viennent ensuite trois autres lectures plus directement orientées vers la célébration du baptême. La lecture de l'Apôtre est également baptismale (Rm 6, 3-11), puis vient le récit de la découverte du tombeau vide par les femmes porteuses de parfums et l'annonce qu'elles reçoivent de l'Ange : "Il est ressuscité".
Chaque lecture de l'Ancien Testament est suivie d'un psaume ou cantique, qui lui fait écho, puis vient la prière sacerdotale qui la conclut. Le passage de l'Ancien au Nouveau Testament s'effectue dans le chant du Gloria in excelsis, tandis que sonnent les cloches. Le Gloria est, par excellence, le chant pascal des chrétiens. Longtemps il fut réservé en Occident à la nuit sainte, tandis que les Églises d'Orient en font leur hymne quotidienne du matin. Après avoir écouté la lecture de saint Paul l'assemblée chante l'Alléluia, qu'entonne le prêtre. Chant du ciel, selon l'Apocalypse (Ap. 19, 1-6), l'Alléluia est aussi le chant de route des chrétiens, assurés d'avoir remporté en Jésus Christ la victoire sur les forces du mal. Saint Augustin présente en ces termes l'Alléluia pascal :
Voici que nous chantons l'Alléluia Il est doux, il est joyeux ; il déborde de grâce et de tendresse Si nous le répétions sans fin, nous nous en lasserions. Quand il revient, quelle fête ! …
Voici la joie, mes frères, la joie d'être ensemble, la joie de chanter des psaumes et des hymnes, la joie d'évoquer la passion et la résurrection du Christ, la oie d'espérer la vie éternelle. Et si un espoir nous emplit d'une joie si vive, que sera-ce lorsqu'il sera comblé ? Oui, en ces jours où retentit l'Alléluia notre esprit n'est plus le même. N'y sentons-nous point comme un parfum de la cité céleste ? ... Là tous les saints seront réunis, ils se rencontreront ceux qui ne s'étaient jamais vus, là se retrouveront ceux qui se connaissaient, là l'union sera parfaite.
Les prières.
Les prières qui concluent chacune des lectures de l'Ancien Testament proviennent toutes du Sacramentaire gélasien (VII° siècle). Chacune se réfère plus ou moins explicitement à la lecture qu'on vient d'entendre. L'une d'entre elles, Deus incommutabilis virtus (après la VII° lecture), développe ce qui devait être, un jour, le thème central de la Constitution Lumen Gentium l'Église est un mystère, elle est "un sacrement merveilleux", c'est-à-dire le signe majeur de l'intervention de Dieu dans le monde tout au long de l'histoire pour le sauvetage de l'humanité. Elle est le signe du renouveau total de la création, du relèvement de tout ce qui était tombé en ruines, du rajeunissement intégral de l'homme en Jésus Christ, qui est le principe de tout. On trouvera difficilement une réflexion théologique plus profonde sur le mystère pascal comme mystère du salut.
Textes liturgiques
Préface
Vraiment, il est juste et bon
de te glorifier, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore en cette nuit
où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Car il est l'Agneau véritable
qui a enlevé le péché du monde :
en mourant, il a détruit notre mort ;
en ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C'est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale
exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel
chantent sans fin l'hymne de ta gloire : Saint'...
Communicantes
Prière Eucharistique I
Dans la communion de toute l'Eglise,
nous célébrons la nuit très sainte
où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus Christ.
Et nous voulons nommer en premier lieu
[…]
Prière Eucharistique II
Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté,
nous voici rassemblés devant toi,
Et, dans la communion de toute l'Eglise,
Nous célébrons la nuit très sainte
où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus Christ.
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père,
nous te prions
[…]
Prière Eucharistique III
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi
Et, dans la communion de toute l'Eglise,
nous célébrons la nuit très sainte
où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus Christ.
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant,
nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons :
[…]
Bénédiction du feu
Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière; daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit ; accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l'éternelle lumière.
Par Jésus.
Oraison sur les offrandes
Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple ; fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle.
Par Jésus.
Oraison après la communion
Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal.
Par Jésus Christ.
Approfondissement